Témoignages
La perte d'un proche est une expérience douloureuse et dévastatrice. C'est un moment où l'on se sent submergé par la tristesse et le chagrin. Les souvenirs et les moments partagés avec cette personne chère semblent s'estomper, laissant un vide immense dans notre cœur. Chaque jour devient un défi, car la douleur de la perte est toujours présente. On se rappelle des moments heureux et on ressent une profonde nostalgie pour ce qui aurait pu être. Le deuil est un voyage difficile et long, mais il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Trouver du soutien auprès de notre entourage et de professionnels peut nous aider à traverser cette période sombre. Peu à peu, nous apprenons à accepter cette perte et à honorer la mémoire de notre proche, tout en continuant à vivre et à trouver la paix intérieure.
Dans cette section vous trouverez des témoignages de personne ayant perdu un proche et leurs histoires
Témoignages en audio
utilisez la playlist pour plus de témoignages
Témoignages écrits
Alain
La morale ou la normalité, je ne sais pas, voudrait que l’on soit triste, abattu, effondré pour la mort de sa mère.
Rien de tout cela pour moi. Aucune émotion de ma part, pas de choc, pas de pleurs, pas de colères, rien du tout.
Ma sœur a prononcé un éloge funèbre à l’église; je n’ai participé à rien, j’étais froid, distant.
J’ai suivi le cortège funéraire jusqu’au cimetière, toujours mécaniquement, sans émotion. Ma sœur a pleuré et je ne comprenais même pas sa tristesse.
Pour moi, ma mère était déjà morte quand j’avais 7 ans, lorsqu’elle avait quitté le foyer familial nous laissant seuls ma sœur, mon frère et moi. Petit garçon de 7 ans, j’ai vécu ce départ comme un abandon et ma mère est morte ce jour là avec une grosse partie de moi.
Avec le recul, ce qui me touche le plus et me rend triste, c’est de ne pas avoir été présent pour ma sœur, incapable de la soutenir et de la consoler.
Ce manque de ressenti et d’émotions lors de son décès me pose question aujourd’hui : Si demain une personne que j’aime meurt, quelle va être ma réaction ? Suis-je insensible ou cela est-il uniquement relié à mon histoire avec ma mère ou les deux ?
Anne-Marie
Deux ans avant son décès, ma mère a été hospitalisée. Mes parents n’ont jamais parlé de la possibilité d’un cancer, ils ont seulement dit que l’opération s’était bien passée. ……
Cependant, l’année de son décès, je savais en mon for intérieur qu’il y avait quelque chose de plus grave et qu’il s’agissait de la phase terminale.
Les parents vivent à jamais dans l’esprit de leurs enfants et là, la prise de conscience que ce n’était pas le cas, était bouleversante pour moi.
……
Le voyage par avion et voiture durait normalement 3 heures. Il pris 16 heures. Reflet indéniable de mon état émotionnel. Un voyage interminable, fait dans un état de tristesse, d’incompréhension, de colère et de peur. Arrivée enfin à minuit …… mon père m’annonce que ma mère a un cancer. Cependant, je ne devais pas parler de cette maladie sauf si l’un ou l’autre entamaient le sujet. Le lendemain … j’ai eu droit à quelques détails. Ce qui était très important pour mes parents était qu’on leur laisse l’espoir. L’espoir fait vivre. Alors on ne parlait pas de maladie, ni de mort. Et la mort guettait toutes nos actions, toutes nos paroles.
…… la maladie adoptait une personnalité presque tangible qui guettait chaque mot comme un spectre. Ainsi, il n’y avait plus d’intimité ou de complicité, même rigoler sonnait comme une fausse note. …… Je me sentais mal à l’aise avec ma mère, elle m’était inconnue. La culpabilité de ce malaise faisait que le gouffre des silences ne pouvait jamais être comblé. Pour une communication qui pouvait être la dernière, toutes choses semblaient superficielles, banales et mornes.
…… j’étais hantée par les pensées de comment ma mère avait passé la nuit. L’horreur de peut-être trouver qu’elle n’y était plus. C’était aussi de l’horreur de passer quelques heures avec une personne chère, où l’espace de partage, par politesse de l’invité que j’étais devenue, était hérissé de non-dits. Le temps avec elle n’était plus authentique.
Le moment de rentrer chez moi était venu. Je savais que c’était la dernière fois que j’allais voir ma mère. Le pire était que cela devait être un au-revoir comme tous les autres, insouciant et gai. Comment c’était possible ! Elle est décédée le même mois à l’hôpital.
Pour moi, ce n’était pas la fin. Le deuil me hantait avec des cauchemars, des ressentis de culpabilité parce que les derniers moments n’avaient pas été authentiques. J’avais de la colère contre elle, contre mon père et tout l’univers. Elle était jeune. J’ai perdu ma mère, les moments rigolos, la complicité … partis à jamais.
Emmanuelle
J’ai enfilé la blouse blanche qu’une infirmière m’a tendue. Me reste la sensation kinesthésique du coton sur ma peau découverte en ce jour du mois d’août. J’ai peur. Qui vais-je trouver derrière la porte de la salle de réanimation? Et surtout, suis-je en capacité de ne rien laisser transparaître de négatif, moi qui de surcroît, supporte mal les hôpitaux, leurs odeurs de désinfectants, leurs chambres confinées? Une voix en moi m’ordonne de passer outre mes états d’âme. Je suis bien portante; il est malade. Mes petites fragilités n’ont rien à faire ici. Je me redresse, raidis un peu mon dos. L’habit blanc m’aide, me protège, met à distance mon tourment intérieur. J’entre. J’évite de regarder les autres malades, harnachés de tuyaux. L’infirmière me mène à mon grand-père. Un vieil homme, aux yeux mi-clos, perdu dans une chemise de nuit d’hôpital, sans dentier, m’apparaît. L’espace d’un instant, c’est un étranger et je cherche désespérément une expression familière. Faire vite, le reconnaître vite avant qu’il ne se rende compte de mon désarroi. Mais je reste là, les bras ballants, silencieuse, le temps de recouvrer mes esprits et de ré-apprivoiser les traits familiers. Je m’assois à ses côtés. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Il ne voit pas, depuis l’accident vasculaire cérébral consécutif à l’opération cardiaque qu’il vient de subir. Il n’entend pas bien non plus depuis des années. Les mots qu’il prononce sont incompréhensibles. A t-il perçu ma présence? « Parlez-lui » me dit l’infirmière, « c’est important ». Je me sens intimidée par les équipes soignantes qui vont et viennent; j’aimerais un peu d’intimité, surtout que je ne sais pas quoi dire… Puis je me lance.
Il fallait parler, alors j’ai parlé. Sans certitude d’être entendue, comprise. Il me « répondait » dans ce qui était pour moi un charabia indescriptible. Peu m’importait, la communication était établie. Il m’a fallu du temps ce premier jour avant de prendre sa main, d’oser le toucher. L’heure du départ est arrivée. Je l’ai embrassé, lui ai dit que je reviendrais le surlendemain.
Je suis revenue. Même rituel de la blouse. Je m’y raccroche. Entrée dans l’espace sacré de l’autre. Mon grand-père est très différent de la veille, excessivement agité, nerveux. Ses gestes saccadés, ses mouvements de tête brusques trahissent sa colère. Je prends place à côté de lui, lui touche la main, lui parle. Sa volubilité ne m’est pas adressée. Ma présence semble lui être indifférente. Bien que triste de ne pouvoir communiquer avec lui, je ne peux m’empêcher d’esquisser un sourire intérieur: c’est bien lui, sanguin, coléreux. Il n’aime pas la deuxième équipe qui prend soin de lui, en alternance avec une autre. Je me mets moi aussi à « mal » aimer ces gens-là. Je les trouve froids, mécaniques, peu humains. Que font-ils donc pour qu’un malade, sourd, quasi-aveugle et aphasique, soit capable de les distinguer des autres et les détester autant? Je dépose un baiser sur son front et promets de revenir.
Deux jours plus tard, je pénètre dans la salle de réanimation. Mon grand-père est calme. Son équipe favorite est de retour. Je lui prends la main, me présente et parle de détails de la vie quotidienne. Il m’écoute, me répond. Je ne comprends pas littéralement mais guette ses mimiques et devine. Puis son visage se crispe, le front se plisse, ses lèvres tremblent et les larmes montent. Mon émotion monte avec; je la ravale du mieux que je peux, lui dis que je suis là, que ma mère et ma grand-mère aussi, que la rééducation de la parole prendra le temps qu’il faudra mais que nous serons à ses côtés. J’ai 20 ans et une foi sans faille dans la vie… Je parle au hasard, sans filet, sans savoir si mes mots sont rassurants, sans savoir si nous évoquons les mêmes sujets. Je pars, avec la délicate et ambivalente prise de conscience que lui et moi sommes en lien et aussi qu’il est conscient de la gravité de son état. J’avais peut-être espéré qu’il ne prendrait pas conscience de sa dégradation physique. J’ai le cœur serré, ne sais plus si l’aveuglement et l’énergie de la colère ne le protègent pas plus que la froide lucidité de la conscience. A moins que ce ne soit moi qui ne supporte pas la souffrance et l’angoisse de celui qui m’a élevée, appris à lire, à compter, celui qui était le dieu de mes 6 ans? Je me console en priant pour qu’il ait compris qu’on ne l’abandonnait pas.
… Jusqu’au dimanche matin où le téléphone a sonné et où j’ai répondu. Ma mère m’interroge « c’est fini ? »: « Oui maman c’est fini ».
Les souvenirs que je garde des jours suivants sont flous. Je me souviens être allée à l’hôpital, avoir fusillé du regard le médecin de l’équipe de garde. Si j’avais pu exprimer ma haine, j’aurais agressé ce médecin, là devant moi, à qui j’en voulais d’avoir laissé mon grand-père arracher ses tuyaux en salle de réanimation. Ce médecin qui passait déjà à d’autres personnes à soigner, sûrement plus jeunes et plus dignes d’attention. En bas, l’employé qui s’occupait des démarches administratives semblait commencer une journée comme une autre, banale. A partir de là, je n’ai plus ressenti grand-chose à part le besoin de soutenir ma famille, avec mes moyens. Les autres étaient dans l’émotion; pas moi. Sa mort n’avait aucune réalité pour moi. Ma mère avait refusé que je l’accompagne pour reconnaître le corps. Seul le cercueil et imaginer mon grand-père enfermé dans une boîte m’a fait mal, lui qui aimait les travaux de plein air.
Longtemps je me suis interrogée: ai-je fait mon deuil ? Comment puis-je ressentir si peu suite au décès de quelqu’un que j’aimais ?
Ce n’est que 15 ans plus tard, lors d’une cure de panchakarma, que le chagrin est remonté.
Maryse
Lors du décès de R. je vivais un moment si douloureux qu’il me semblait que personne ne pouvait comprendre l’intensité de ma souffrance. Il me semblait qu’il existait un univers de différence entre ce que je ressentais et les autres, comme si je rentrais dans un gouffre profond de douleur alors que la vie à côté continuait : le soleil se levait, les oiseaux chantaient, des personnes rigolaient au même moment où pour elle tout s’était arrêté.
Dans cet état de fragilité intérieure, assaillie par les émotions, j’étais à ce moment-là plus sensible aussi aux petites attentions des personnes compatissantes. Je me souviens de ce texto qui m’avait réchauffé le cœur : «Si tu as besoin de quoi que ce soit je suis là ». Les choses les plus anodines de la vie prenaient tout leur sens. Pas besoin de long discours, une simple attention à mon égard et une proposition d’aide suffisait à me mettre du baume au cœur !
Des images de son corps inerte m’ont longtemps hantée.
Ce n’est pas la mort elle-même la plus dure mais ce qu’elle laisse de ce corps physique qui n’était plus représentatif de la personne avec qui j’avais partagé plein de choses. Ce corps sans vie faisait qu’elle n’était plus là, c’était sa dépouille mais pas elle. Alors où était parti ce qui faisait d’elle un être humain ?
Bien sûr intellectuellement je savais qu’elle avait une âme et que c’est ça qui perdurerait. Mais malgré tout l’absence physique était difficile à vivre.
Chaque fois que je passais devant sa maison aux volets fermés, je m’attendais à voir la porte s’ouvrir. Rentrer dans sa maison sans elle m’était insupportable. L’ayant mise au lit le soir et retrouvée décédée alors que je venais la lever, ce fût un choc pour moi où je pris conscience de la fragilité de la vie.
Le soir avant son décès, elle m’avait demandée de rester dormir avec elle. Elle devait savoir en son fort intérieur qu’il allait se produire quelque chose cette nuit et moi aussi d’ailleurs mais j’ai refusé car j’ai eu peur de ce basculement, peur d’affronter la mort en face. Bien sûr après j’ai regretté de ne pas l’avoir accompagnée, j’ai culpabilisé tout en me disant que c’était aussi comme ça, que je n’avais pas pu à ce moment faire face à la mort car je n’étais pas prête. En même temps j’avais eu l’intuition mais en même temps une partie de moi refusait et voulait croire en la permanence de la vie.
Les matins suivants sont décès je réalisais que moi aussi j’étais mortelle et que chaque matin où je me réveillais j’avais en quelque sorte gagné un jour de plus. Puis avec le temps, la souffrance s’allège et les souvenirs reviennent. Même si la personne n’est plus là matériellement, on se rend compte qu’elle continue de vivre en nous au travers des souvenirs, il reste une trace invisible, un lien immatériel, le même que quand on pense à quelqu’un qui se trouve à des milliers de kilomètres de soi. La personne aimée en quelque sorte ne meurt jamais.
Deux ans plus tard je fus confrontée de près physiquement et psychiquement à la mort d’un de mes chats préférés.
C’était la première fois, tout comme pour R. que je touchais de près la mort. Je décidais d’accompagner mon gentil minou jusqu’à son dernier souffle et là pareillement, le plus dur à vivre et qui me fais encore souffrir à l’heure où j’écris est le souvenir du moment où la vie a quitté son corps à travers une dernière tension de tout son corps et un râle.
Je ne pense pas qu’il ait souffert mais pour moi cette étape reste encore douloureuse. Son corps est rapidement devenu tout froid et tout dur et là encore ce constat de la vie qui se retire et disparait en laissant un vide qui au début n’est que pleurs, tristesse puis petit à petit ce vide rempli de dégoût pour ce corps inerte se transforme au fil du temps en remémoration de souvenirs agréables.
Patricia
Mon deuil de toi, tonton, tonton Sylvio, toi qui m’as élevée alors que je n’étais pas ta fille. Mon deuil a commencé avant ta mort. Toi mon père de cœur, j’ai commencé ton deuil, lorsque j’ai pu te dire « je t’aime ». Un an avant ta mort, le diagnostic tombe. « Cancer ». Coup de tonnerre, tout s’effondre. C’est tellement violent, quelque chose se déchire, je ne veux pas, je relis le courrier, et, pourtant je sais, je sais que c’est un cancer, un cancer très agressif, irréversible.
Alors durant cette année, je dois me faire à l’idée que tu ne vas pas guérir. A ma souffrance de te perdre s’ajoute la souffrance de ne pas te dire la vérité. Je sais que tu sais. Tes regards, tes questions indirectes me le disent. Quelle souffrance de se taire, me plier aux exigences de la famille et jouer à « faire semblant ». Souvent j’ai eu peur, peur de ne pas y arriver, ne pas savoir t’accompagner, peur que ma souffrance m’enferme et me ferme à tes besoins.
Trois semaines avant ta mort, une opération est prévue, je t’emmène à l’hôpital. Tu me parles de ta vie comme tu ne l’as jamais fait. Je te vois dans cette chambre d’hôpital, blanche, froide. Je te vois tellement fragile et désemparé, même si ta pudeur t’empêche de le montrer. C’est terrible pour moi de te laisser là. Tous les jours je viens te voir. En partant je te prends délicatement dans mes bras et te dis combien je t’aime, et à chaque fois j’ai mal dans moi. Est-ce que demain, je pourrai encore te le dire ? Tout mon être souffre car je sais que c’est peut-être la dernière fois. Sur le retour, seule dans la voiture, je peux pleurer, crier… Tu es opéré, le diagnostic confirme mes angoisses. Cancer généralisé, plus rien à faire. Je ne réalise pas, je suis dans un état second, comme anesthésiée.
Quelques jours plus tard, je te ramène chez toi. Je sais, tu sais, tu sais que je sais. Durant le trajet nous parlons de tout et de rien, heureusement qu’ils existent « ces tout et ces rien ». Je nettoie ta bouche remplie de pustules blanchâtres qui te font souffrir. Et puis il y a ces moments suspendus, hors du temps, où nous nous parlons sans les mots, je prends délicatement tes mains ou tes pieds et je te masse, avec le plus de douceur, de délicatesse possible et avec toute la tendresse qui est là. Tu te détends, ton regard me sourit. Combien cela me fait du bien ! Ces nombreuses caresses t’apaisent et en même temps apaisent ma souffrance. Et toi, toi qui souffre terriblement, aujourd’hui tu n’arrives plus à tenir debout, tu n’arrives presque plus à parler, ta voix s’éteint et devient inaudible. Et pourtant tu fais des efforts, c’est difficile de te voir, te voir dans cet état, te voir souffrir. Là je me sens tellement démunie et impuissante.
Aujourd’hui ta respiration a changé, la fin est proche, très proche. Une peur panique m’envahit, je vais me retrouver devant ma plus grande peur, la mort, être là aux derniers instant, au dernier souffle. Quelques heures plus tard je me penche, j’écoute ta respiration pour me rassurer.
Je sens un léger souffle comme une caresse sur ma joue, comme un cadeau. Je suis emportée, touchée au plus profond de mon être, et je baigne dans un état de sérénité d’une intensité incroyable. Quel cadeau ! C’est bouleversant de se sentir à la fois profondément triste et soulagée. Enfin tu ne souffres plus. Je participe aux soins mortuaires, cela m’aide énormément à te dire aurevoir. Puis très vite l’agitation de l’organisation des obsèques. Un tourbillon qui me plonge dans un autre état. Les jours de veille, les repas de famille, quel réconfort de parler de toi, Sylvio, mon oncle, toi que je n’ai jamais pu appeler « papa ». Quel réconfort de se rappeler des bons moments, de pleurer ensemble, de rire ensemble.
Poser le couvercle du cercueil, te dire adieu. Je ne te verrai plus. Visser le couvercle, je dois le faire. Je me sens oppressée tendue, qu’est ce qui va se passer ? Et après, après toute cette agitation, le silence. La réalité de la perte, du manque, c’est vraiment vrai, « tu es mort », je ne t’entendrai plus jamais rire.
La violence de la douleur de la souffrance d’avant ta mort s’est transformée. Mes larmes étaient remplies du vide que tu laissais. Ces vides se sont remplis tout doucement. La tristesse, la douleur du manque, de ne plus rien vivre avec toi se sont elles aussi transformées, diluées, effacées, estompées. Maintenant je peux penser à toi parler de toi sans qu’une vague de chagrin m’emporte, la joie, le bonheur de tous ces moments vécus, nos rires et la vie a trouvé un autre équilibre. Ce voyage est terminé. Merci du cadeau inestimable d’avoir accepté que je m’occupe de toi, d’être mort dans mes bras, de tout ce que j’ai traversé et appris sur moi. Merci pour ces prises de conscience pas toujours facile à accepter.
A quelques jours de ta mort tu m’as demandé : «Est ce que c’est fini ? ». Les mots sont restés bloqués. Impossible de parler, de répondre. L’approche de la mort oblige le vrai, l’authentique, la vérité et pourtant je devais constater mon incapacité à dire. Je devais constater aussi mon profond regret de ne pas avoir pu parler de la mort avec toi. Regret de ne pas t’avoir remercié pour tout ce que tu m’as apporté, pour toutes ces belles valeurs que tu m’as inculquées. Te dire « Merci. Simplement Merci. Tu peux partir tranquille, en paix ». Cela j’en ai souffert, j’en ai eu honte. Ce constat a opéré comme une déflagration et ce fut le début d’un travail intense sur la mort que j’entreprendrai l’année suivante au centre Ayurvédique Arkadhya.
Faire son deuil, dire à l’autre je t’aime et le laisser partir.
Association Le Passage
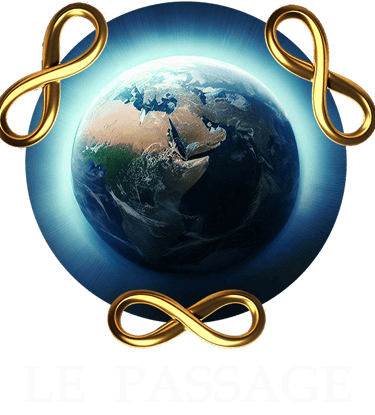

Téléphone
présidente : 05.53.79.71.90
Vice présidente : 06 74 22 62 50









